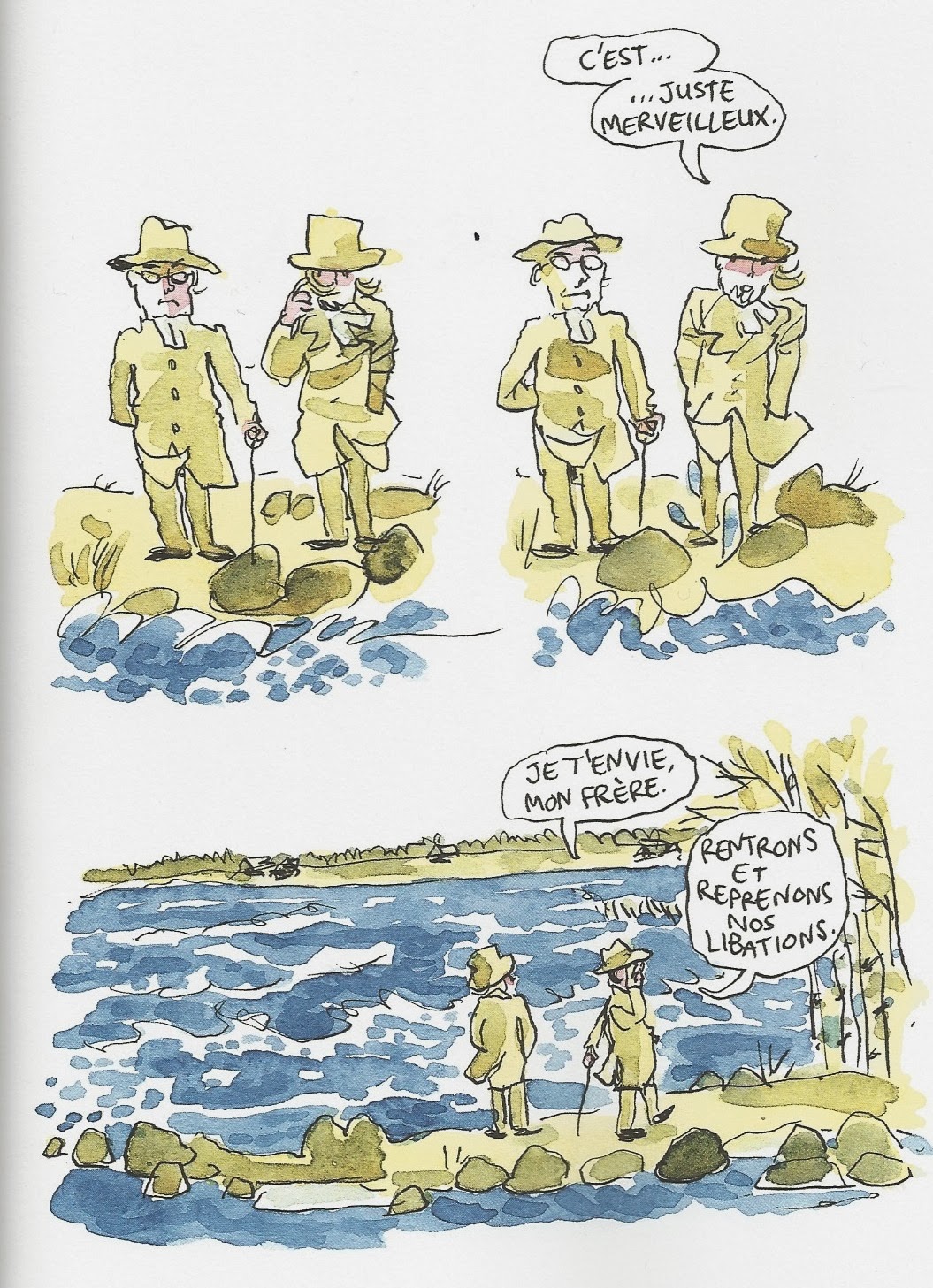Hélène Clerc-Murgier, Abbesses, Éditions Jacqueline Chambon et Actes Sud, 2013.
Ceci est un roman policier
prenant place dans le Paris du début du XVIIe siècle.
Le héros en est Jacques
Chevassut, lieutenant criminel au Châtelet. Il est confronté à une série de
cadavres d’hommes, dont les corps portent une sorte de signe de croix. Bientôt
son ami et premier conseiller Pierre Boivin disparaît. L’enquête du lieutenant
l’emmène à l’abbaye de Montmartre, dans les cercles alchimistes.
Alors ?
Je commence par les points
faibles. Tout d’abord, ayant grandi à l’école d’Agatha Christie, j’aime les
romans policiers planplans et classiques. Les trucs alchimistes où les symboles
s’emboîtent les uns dans les autres sans queue ni tête, ce n’est pas ma tasse
de thé. Mais c’est un goût personnel, que tout le monde n’a pas.
Ce roman possède par ailleurs les
deux défauts classiques des romans historiques : la pédagogie et le name
dropping (le placement de
noms propres ?). La pédagogie : tout est bien expliqué, c’est
instructif, mais peu littéraire. Le placement de noms propres (travers
très présent dans la série Nicolas Le Floch de Jean-François Parot) :
l’auteur tient à montrer qu’elle est hyper documentée. En l’occurrence, aucun
nom de rue ne nous épargné.
 |
| J. Voet, Portrait de jeune homme, XVIIe siècle, Saint-Pétersbourg, Ermitage, image M&M. |
Et les qualités ? Il faut
reconnaître que la reconstitution historique est impressionnante, même si pas
toujours subtile. J’ai particulièrement apprécié l’atmosphère des rues, les métiers,
les cris, les odeurs, les jardins. Tout ceux qui veulent découvrir le Paris du
XVIIe seront ravis je pense. Quant à l’intrigue, même si j’ai relevé
quelques incohérences, elle est plutôt bien menée dans l’ensemble et la lecture
s’avère tout à fait prenante.
Ce roman était donc une agréable
distraction. J’encourage l’auteur à persévérer, ses prochains romans seront
sans doute plus libérés à l’égard de leur documentation.
Petite mention : la langue
contient des expressions archaïques, pour faire couleur locale, et cela passe
plutôt très bien.
Il fut immédiatement frappé par
l’odeur particulière de boue qui se dégageait dans la ville, âpre senteur,
tenace, écoeurante et qui causait, mêlée aux immondices et au fumier accumulé,
de grandes vapeurs puantes capables d’infecter tout un quartier. Un carrosse
passa à vive allure, le cocher hurlant et faisant claquer son fouet dans un
vacarme assourdissant.